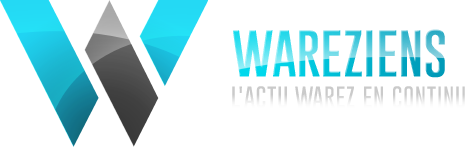« Passez-vous plus de temps sur Internet que vous ne l’auriez pensé initialement ? Y a-t-il des sites que vous ne pouvez éviter ? Trouvez-vous difficile d’être déconnecté durant plusieurs jours ? » Ces questions extraites du test d’Orman, relayé par la presse magazine, permettraient de diagnostiquer une dépendance à Internet (1). En suivant ce type d’évaluation, près de la moitié de la population connectée serait atteinte. Et la plus formidable pandémie de l’histoire serait en train de se répandre sur la planète. La Chine a déjà fait de cette « pathologie » une priorité de santé publique. Des réseaux internationaux travaillent d’arrache-pied à élaborer des diagnostics standardisés, des essais cliniques, des protocoles de traitement et des campagnes de prévention.
C’est un fait : un nombre croissant d’internautes peinent à se déconnecter. Leur activité en ligne déborde peu à peu sur les autres secteurs de leur existence, au détriment de leur sociabilité, de leur travail, de leurs études. S’agit-il pour autant d’une maladie ? Le caractère pathologique du phénomène est loin de faire consensus au sein de la communauté scientifique. En 2008, l’inclusion de la dépendance à Internet dans la cinquième édition de son répertoire des maladies mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou DSM-5) (2) a été rejetée faute d’éléments convaincants. Mais le débat se poursuit, notamment au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en vue de la publication en 2017 du manuel de classification internationale des maladies.
L’histoire de la cyberdépendance remonte aux années 1970 lorsque Joseph Weizenbaum, ingénieur à l’Institut de technologie du Massachusetts (MIT), constate chez ses collègues un « acharnement à programmer » caractérisé par un temps de connexion élevé, une hygiène de vie négligée ainsi qu’une désocialisation (3) — tableau typique, selon lui, d’un « trouble mental ». Dans les années 1990, les craintes et l’enthousiasme qui accompagnent le développement d’Internet encouragent les recherches sur l’expérience du monde virtuel et sur ses propriétés potentiellement addictives : anonymat, évasion, accessibilité et interactivité. La cyberdépendance se décline alors selon trois sous-dimensions : le jeu vidéo, le cybersexe et la sociabilité. Mais, avant d’être prise au sérieux, la pathologie fut d’abord introduite comme une farce. C’est pour critiquer la multiplication des troubles répertoriés dans le DSM — de cent six en 1952 à quatre cents en 1994 — que le psychiatre new-yorkais Ivan Goldberg imagine en 1996 un désordre qu’il désigne comme « ridicule », celui de l’addiction à Internet (4). Il poste sur un forum de thérapeutes une parodie de diagnostic clinique.
La même année, cette maladie entre dans le lexique médical par une voie plus orthodoxe : Kimberly S. Young, psychologue à Pittsburgh, applique le diagnostic reconnu du « jeu pathologique » aux pratiques en ligne et diffuse cette idée sur des forums de discussion de personnes autodiagnostiquées. La clinicienne prolonge l’expérience : elle achète des encarts publicitaires en ligne et acquiert même le mot-clé « Internet addiction » sur Yahoo (5). Les répondants s’avèrent nombreux et les demandes de consultation, bien réelles. Dorénavant, le mécanisme psychologique de l’« impulsion » — caractérisé par le contrôle malaisé, voire impossible, d’un comportement pourtant identifié comme nocif — sera identifié comme la cause des problèmes psychologiques et sociaux liés à l’utilisation d’Internet : incapacité de résister au désir de connexion et sensation de manque, avec leurs conséquences sociales négatives (divorce, difficultés professionnelles, scolaires et financières).
En 2013, les rédacteurs du DSM-5 suppriment le « jeu pathologique » de la catégorie des « troubles du contrôle de l’impulsion (6) ». Selon eux, la disposition à ne pas décoller de son écran pourrait se ranger dans une nouvelle catégorie générique, celle des « troubles liés à une substance et addictifs (7) ». L’idée suscite aussitôt la controverse : Allen Frances, rédacteur de la précédente version du DSM, et Stanton Peele, théoricien des dépendances comportementales, dénoncent la biologisation du concept d’addiction (8). En effet, remplacer le profil de « dépendant » par celui d’« addict » (léger, modéré ou sévère), et ajouter au tableau le symptôme de « désir irrésistible », implique l’existence d’un risque biologique commun à l’addiction à Internet, au jeu et à la drogue. Le symptôme de « désir », causé théoriquement par un dérèglement dans la production de dopamine, est diagnostiqué par une simple question posée au patient : « Avez-vous déjà eu tellement envie de prendre de la drogue que vous ne pouviez penser à rien d’autre (9) ? »
L’enjeu est crucial : selon cette approche, les individus diagnostiqués — à tort ou à raison — comme cyberdépendants pourraient recevoir un traitement pharmacologique antidésir. Mais la difficulté à se déconnecter durant une semaine est-elle le symptôme d’un besoin physiologique, ou celui d’une société où les activités sociales, scolaires et professionnelles passent toutes par l’intermédiaire de la Toile ? Lieu de l’excès, Internet peut tout aussi bien contribuer à fournir le remède : il offre un espace d’échange entre les utilisateurs et les cliniciens à travers les forums d’information, un outil de traitement grâce aux consultations psychologiques en ligne, et même des applications permettant de limiter le temps de connexion aux sites chronophages — le repose-poignet Pavlov Poke, par exemple, qui délivre une petite décharge électrique en cas de visite prolongée ou de connexion à un site interdit.
Au-delà de la controverse médicale, la caractérisation de l’addiction à Internet nourrit une critique plus directement politique. Pour les recherches à venir, les rédacteurs du DSM-5 ont retenu le diagnostic du psychiatre chinois Tao Ran, lequel repère l’addiction à partir de « six heures de connexion quotidiennes durant plus de trois mois, hors activités scolaires et professionnelles ». Mais au nom de quelles normes et de quelles valeurs élabore-t-on un diagnostic scientifique qui hiérarchise des pratiques sociales en fonction de leur productivité économique ? Quand il retranche de l’addiction à Internet le temps de travail et d’apprentissage, le Dr Tao souligne en creux l’impensé de cette notion. Dans un univers marqué par l’injonction professionnelle et éducative à la connexion permanente, une frontière morale séparerait pratiques saines et pratiques pathologiques en fonction d’un critère implicite d’utilité économique. Il serait normal de rester huit heures par jour au bureau les yeux rivés sur un tableur ; mais six heures quotidiennes devant un jeu vidéo appelleraient un traitement médical. L’addiction à Internet se présente dans le DSM-5 comme une maladie décontextualisée des systèmes économiques et des outils informatiques qui tirent profit de la dépendance : industries du jeu vidéo et des logiciels, réseaux sociaux.
Le seul prisme neuroscientifique réduit le champ de recherche et les solutions possibles. A ce jour, la gestion des usages excessifs d’Internet demeure sociale, culturelle et politique. Elle ne fait l’objet d’aucun consensus international. Si les Etats-Unis et la Chine adhèrent à l’hypothèse standardisée d’une maladie neurologique, ils diffèrent par les modes de prise en charge. Les premiers instaurent un système de soins concurrentiel et privatisé déterminé par les assurances privées ; le second a créé des camps de redressement sur le mode militaire, qui impliquent un enfermement hospitalier et la reconnaissance de la maladie par le patient. La France et le Québec privilégient une perspective compréhensive et psychosociale au cas par cas. Après la traduction du questionnaire diagnostique de Young en 2006, le Japon a découvert l’ampleur de ce « problème social » et finance des centres de traitement.
Virginie Bueno
Maîtresse de conférences en sociologie, université de Montréal, Québec.(1) Marc Valleur et Dan Velea, « Les addictions sans drogue(s) » (PDF), Toxibase, no 6, Lyon, juin 2002.
(2) Lire Gérard Pommier, « La bible américaine de la santé mentale », Le Monde diplomatique, décembre 2011.
(3) Joseph Weizenbaum, Puissance de l’ordinateur et raison de l’homme : du jugement au calcul, Editions d’informatique, Boulogne-Billancourt, 1981.
(4) Cf. David Wallis, « Just click no », The New Yorker, 13 janvier 1997.
(5) Kimberly S. Young, « Internet addiction : The emergence of a new clinical disorder » (PDF), CyberPsychology & Behavior, vol. 1, no 3, New Rochelle (New York), 1996.
(6) Ting-Kai Li, Charles P. O’Brien et Nora Volkow, « What’s in a word ? Addiction versus dependence in DSM-5 », American Journal of Psychiatry, vol. 163, no 5, Arlington (Virginie), 2006.
(7) Nancy M. Petry et Charles P. O’Brien, « Internet gaming disorder and the DSM-5 », Addiction, vol. 108, no 7, Hoboken (New Jersey), 2013.
(8) Allen Frances, Saving Normal : An Insider’s Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life, HarperCollins, New York, 2013 ; Stanton Peele, « Politics in the diagnosis of addiction », Huffington Post, 15 mai 2012.
(9) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., Association américaine de psychiatrie, Arlington, 2013.
—-> source : http://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/BUENO/53095